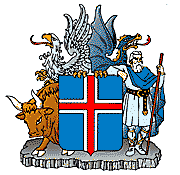 L'hymne national islandais L'hymne national islandais
Steingrímur J. ÞorsteinssonL'hymne national islandais, le chant de louange Ó, guð vors lands („Oh Dieu de notre patrie!“), est à l'origine un psaume composé pour une occasion spéciale, et il n'est sans doute jamais venu à l'esprit des auteurs du texte et de la mélodie que leur oeuvre serait adoptée comme hymne natïonal; aussi ne le fut-elle que plus d'un tiers de siècle plus tard. En 1874, 1000 ans s'étaient écoulés depuis le moment où le Norvégien Ingólfur Arnarson, le premier de tous, s'établit définitivement en Islande. Cela fut l'occasion de nombreuses fêtes dans le pays entier, mais la fête nationale principale fut célébrée à Thingvellir, l'ancien siège du parlement, et à Reykjavík. L'hymne fut composé pour cette fête, cf. les mots „Íslands þúsund ár“ („Mille ans de l'Islande“) qui se trouvent dans toutes les trois strophes - et le titre de l'édition originale de la poésie et de la musique (Reykjavík, 1874) est: Hymne en commémoration des mille ans de l'Islande. Conformément au décret royal du 8 sept. 1873, un office divin public devait être célébré dans toutes les églises du pays afin de commémorer le millénaire de la colonisation de l'Islande au cours de l'été 1874; l'évêque d'Islande devait fixer la date pour la messe et choisir le texte du sermon. Ce même automne, l'évêque, dr. Pétur Pétursson, annonça que le jour de la messe serait le 2 août et que le texte serait le 90ème psaume de David, vers 1 à 4 et 12 à 17. L'existence de l'hymne national islandais est due à cette messe solennelle, et le choix du texte en fut le motif. Au moment de la publication de la circulaire épiscopale, le pasteur Matthías Jochumsson (1835-1920) s'embarqua pour son troisième voyage à l'étranger (il en fit onze en tout). Fils d'une famille de paysans nombreuse et pauvre, il avait fait des études tardives, aidé par des gens qui admiraient son intelligence. Après avoir passé son examen de théologie à Reykjavík il s'était fait pasteur dans une paroisse pauvre des environs, mais avait abandonné le pastorat cet automne de 1873, alors que la perte récente de sa femme l'avait profondément bouleversé et qu'en outre il était, à ce moment, en proie à une de ces nombreuses crises religieuses de la première moitié de sa vie. Durant les années suivantes il fut rédacteur en chef du plus ancien des journaux islandais, reprenant ensuite son service pastoral dans des paroisses importantes qu'il n'abandonna qu'au début du vingtième siècle, au moment où, le premier de tous les Islandais, il reçut du parlement une pension de poète, dont il bénéficia durant les vingt années qu'il lui restait à vivre. Des grands poètes islandais de tous les temps, Matthías Jochumsson est un des plus universels, spirituels, éloquents - productifs et inégaux. Il est surtout connu par ses meilleures poésies, des traductions magistrales de quelques-unes des oeuvres maîtresses de la littérature mondiale, des essais et une correspondance variés, pleins de verve, qui feront vivre sa mémoire. Plus qu'à tout autre on lui a donné le titre honorifique de ÑPoète national des Islandais". Il est avant tout le poète de la vie et de la foi, ce qui se révèle p. ex. dans l'hymne national, - quoiqu'il soit injuste à l'égard du poète de compter cette pièce parmi ses toutes premières poésies. Cette oeuvre fut composée en Grande-Bretagne au cours de l'hiver 1873-74, la première strophe à Edimbourg, les deux dernières - que Matthías Jochumsson n'apprécia d'ailleurs jamais beaucoup - à Londres. Une dizaine d'années s'étaient alors écoulées depuis le moment où son activité poétique avait commencé à attirer l'attention du public, et ce ne fut que dix ans plus tard que parut son premier recueil lyrique. L'auteur de la musique, Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1926), se trouvait dans une situation tout autre que Matthías Jochumsson: fils d'un des plus hauts fonctionnaires du pays, le président de la cour suprême, il vécut la plus grande partie de sa vie à l'étranger; théologien, il fit - le premier parmi les Islandais - de la musique sa profession. Après cinq années d'études musicales, à Copenhague, Edimbourg et Leipzig, il venait de s'établir comme professeur de musique et pianiste à Edimbourg, son futur lieu de séjour, lorsque Matthías Jochumsson y vint, à l'automne 1873, et s'installa chez lui, parce qu'ils étaient camarades d'école malgré une différence d'âge de 12 ans. Matthías Jochumsson, qui après avoir composé la première strophe de l'hymne l'avait montrée à Sveinbjörn Sveinbjörnsson, a écrit dans son autobiographie: ÑSveinbjörn Sveinbjörnsson examina de près le texte et déclara qu'il ne se sentait pas capable de le mettre en musique; au cours de l'hiver, je l'ai ensuite incité, conjuré d'écrire la musique pour le cantique. Et finalement l'air était prêt au printemps et arriva en Islande juste avant la fête nationale." - Par la suite, Sveinbjörn Sveinbjörnsson resta à Edimbourg, à l'exception des huit dernières années de sa vie, qu'il passa à Winnipeg, Reykjavík et Copenhague, où il trouva la mort assis devant son piano. - Mais depuis le moment où, âgé de 27 ans, il mit en musique Ó, guð vors lands, il composa de multiples oeuvres musicales, dont certains airs excellents sur des poésies islandaises, quoique la plupart du temps il eût peu de contact direct avec son pays et gagnât sa réputation de compositeur plus tôt dans le pays de son séjour que dans sa patrie. Cependant ses compositions sont conçues dans un esprit nordique plutôt qu'anglo-saxon. Et dans le groupe, peu nombreux, des compositeurs islandais, il fait à la fois figure de pionnier et de maître. L'hymne ne semble pas pourtant avoir attiré spécialement l'attention, ni le texte ni la musique, quand il fut exécuté la première fois par un choeur mixte, au cours de trois messes solennelles célébrées à la cathédrale de Reykjavík, le dimanche 2 août 1874. Ce jour-là furent chantées aussi 7 poésies laudatives écrites par Matthías Jochumsson, sur la demande du comité de la fête - la plupart en un seul jour - si grande était sa facilité. Mais l'hymne est parmi les rares oeuvres qu'il composa à l'occasion de la fête nationale de sa propre initiative. Des quatre coins de l'Islande, les gens s'étaient rendus à la fête, et de hauts personnages étaient venus de certains pays d'Europe et d'Amérique. Parmi eux se trouvait Christian IX, roi de Danemark, qui, le premier de ses rois, rendit visite à l'Islande. Il apporta au pays une nouvelle constitution comprenant de nouveaux droits considérables (pouvoir législatif, autonomie financière partielle). Cela marqua une des étapes dans la reconquête de l'indépendance (perdue 1262-64), les suivantes étant: l'établissement d'un gouvernement local (ministre d'Islande islandais, domicilié à Reykjavík), 1904, Islande état souverain en union personnelle avec le Danemark (le roi de Danemark en même temps roi d'Islande), ler déc. 1918 - et enfin république (avec un président islandais), 17 juin 1944. Pendant que la souveraineté était encore loin, il ne pouvait être question d'aucun hymne national au sens usuel. Mais quand les Islandais voulaient chanter en l'honneur de leur patrie, la première place était tenue, au 19e et jusqu'au début du vingtième siècle, par Eldgamla Ísafold , poème composé par Bjarni Thorarensen (1786-1841; écrit à Copenhague, probablement 1808-9). Mais pour deux raisons et malgré une grande popularité, cette poésie ne put être adoptée comme hymne national: la nostalgie y est exprimée en termes offensifs pour le pays de séjour, sauf dans la première et la dernière strophe, que l'on chantait d'ailleurs le plus souvent. Mais ensuite, et surtout, ce poème se chantait sous la musique de l'hymne national anglais (quoique composé originairement, paraît-il, sur musique de Du Puy). Au cours du dernier quart du 19e siècle, Ó, guð vors lands était souvent chanté par des sociétés de chant, mais ce n'est que durant la période entre l'établissement du gouvernement local et l'obtention de la souveraineté, que cette oeuvre s'est acquis le droit de coutume d'hymne national. Lors de la cérémonie d'institution de la souveraineté elle fut jouée comme hymne national, ce qu'elle est restée depuis. - L'état islandais acquit le droit d'auteur pour la musique - jusqu'alors propriété d'un éditeur danois - en 1948, et pour la poésie en 1949. Comme hymne national, l'æuvre a incontestablement des défauts. Que le poème soit plutôt un cantique qu'un chant patriotique, cela, certes, ne gêne guère les Islandais. Mais la musique embrasse une gamme si vaste que beaucoup de gens ne peuvent la chanter. Parmi les autres chants patriotiques auxquels les gens ont alors recours depuis quelques dizaines d'années, l'on peut citer Íslandsvísur (Ég vil elska mitt land) de Jón Trausti (pseudonyme pour Gudmundur Magnússon, 1873-1918), musique du pasteur Bjarni Thorsteinsson (1861-1938), et Ísland ögrum skorið, strophe du poème d'Eggert Ólafsson (1726-1768), musique de Sigvaldi Kaldalóns (1881-1946). Mais ni ces airs, ni d'autres n'ont pu supplanter Ó, guð vors lands comme hymne national. Cette oeuvre a même acquis un caractère d'autant plus sacré qu'on ne l'a pas usée par un emploi de tous les jours. On révère la poésie sublime du poème - surtout de la première strophe, qui seule est chantée d'habitude - et la solennelle et émouvante musique touche le coeur des Islandais. Avant-propos á la publication emanant du Cabinet du Premier Ministre d'Islande 1957
© Le gouvernement d´Islande |